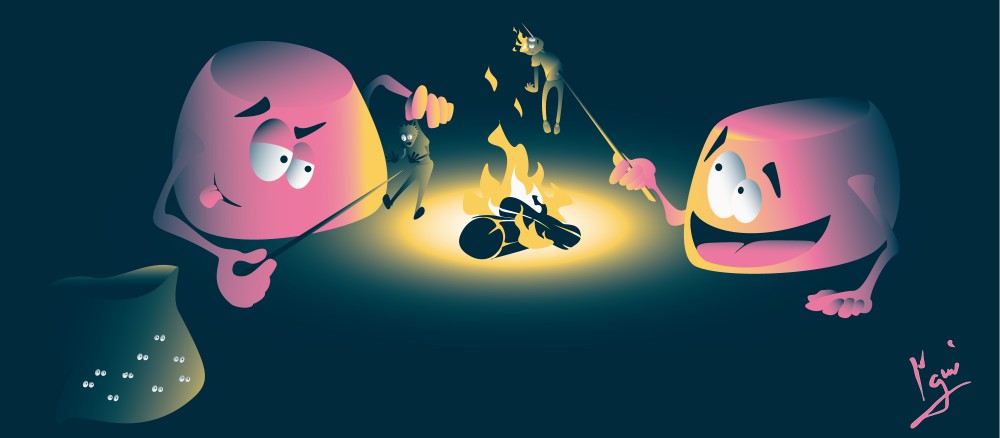De Myriam à Guillaume
Cher Guillaume,
Je suis en r’tard en r’tard comme disait le Lapin. Je suis en retard de quelques réponses à tes tergiversations. Alors aujourd’hui, je passe en mode Lièvre de Mars-avril et on y va, confiture sur le nez à l’heure du thé: parlons de la fuite du temps et de l’heure d’hiver.
De fait, je te lisais et me disais que je fait partie de ces gens que tu mentionnes et qui ont beaucoup de mal avec les changements d’heure annuels. Pour te dire, je mets toujours quelques mois à changer l’heure sur l’horloge de ma cuisine: ça m’angoisse de savoir que même le temps n’est pas stable. Bien sûr, je sais bien que cette ellipse n’est due qu’à une certaine conjoncture politico-économique, mais ça non plus ça ne rassure pas. Quand le pouvoir autoritaire et injonctif de l’Etat va jusqu’à pouvoir tuer une heure pour la ressusciter quelque mois plus tard, c’est quand même inquiétant. Et je suis quelqu’un de très inquiet et angoissé de nature, sous ce léthargique vernis.
Alors ça m’inquiète toujours cette histoire d’heure qui s’évapore. D’autant plus que, quand on est, comme moi, passablement instable, on se raccroche comme on peut à des choses qui semblent immuables, doudous ordonnés: le lever du soleil chaque jour; la mer immense; les cartographies; le goût des choses que l’on boit et mange; le poids du chat sur la couverture le matin; la sensation du papier des livres sous les doigts; le goût du sel sur la peau après la baignade; la croissance des plantes; allumer les lampes dans un ordre précis, dans le salon, quand le soir tombe dehors; la brûlure du feu de bois sur les mains; l’odeur acide du café qui coule le matin; le petit clic de la mollette de la radio qu’on met en marche; la vaisselle solitaire et furieuse qui conquiert l’évier vaincu; le poids des sacs de courses au bout des bras, qui retourne les coudes; la chaleur palpitante et joyeuse des corps amis; les miettes de tabac et les grains de sucre qui s’incrustent sous les ongles quand on cherche les clefs au fond du sac; le vol des mouettes devant la fenêtre et les yeux jaunes du chat qui s’allument en les regardant passer, oublieuses du danger, comme ceux de l’amant au plaisir; le roulis des vagues sur les pieds nus rougissant; les visages modelés dans le sable; le reflet de la nuit sur le bitume des trottoirs vides; l’odeur de pluie, de poussière de ville et de feuilles sèches après les orages d’été; le silence des oiseaux.
Le sens de l’ordre vire à l’obsession chez les étrangers à l’équilibre, celui de la symétrie est une griffure qui se prolonge, un malaise sourd, immédiatement étouffé par le rétablissement de l’alignement des tableaux sur le mur, le retour discret d’une heure enf(o)uie, forget-me-not du passage du temps. Alors on se remet à aimer: que les gens répondent au téléphone; que les objets brisés gisent, immobiles et résignés juste sous les yeux; que la flammèche du gaz éclate à la première semonce électrique, sous la casserole où doivent rissoler les oignons de la soupe; leur doux chuintement satisfait quand ils se décident à cracher l’eau de leur végétation; les chansons, toujours les mêmes, pour chaque état du corps et de l’esprit; l’encre rétive sur les doigts, les jours de cours; le moment suspendu au-dessus du vide où toutes les pièces d’un puzzle s’emboîtent enfin parfaitement; celui où on pleure juste quand il faut devant un film, où on ne rit pas quand il faut; le sifflement régulier du vent sous la porte; les motifs labyrinthiques des tapis; compter les marches, toutes les marches de tous les escalier et constater avec soulagement qu’encore une fois, il y en a 18 entre les deux étages; le cliquetis du passage des minutes à la montre au poignet droit, la nuit, sous l’oreiller; le sentiment glorieux de la cuisson parfaite des pâtes; arriver juste une minute avant l’heure dite à un rendez-vous à l’autre bout de la ville en ayant pris les transports; acheter des fruits au marché et que le vendeur tombe pile sur un kilo, comme ça; découvrir un livre à l’envers dans la bibliothèque et le remettre à l’endroit; faire mat avec un pion oublié dans un coin de l’échiquier et effacer le petit sourire satisfait de l’adversaire en le transformant en un pli amer de matador encorné par une maigre vachette; prendre le bon chemin dans les couloirs oubliés du métro, plongée dans la stupeur d’une nuit trop courte et trop pleine; les routes désertes et le regard fixe par la fenêtre passager d’un véhicule en mouvement, stroboscopiques arbustes qui impriment leur ombre portée sur la rétine paresseuse.
Alors en fait, cette heure d’hiver perdue contient tout ça, toutes ces choses qui font que la vie est plus que ce qu’elle ne dure, qu’elle s’étend au-delà du temps ligné. Escamoter cette heure c’est réduire, non le temps mais l’étendue physique du temps, son sens.
Alors je la pleure cette heure disparue. Elle laisse dans son sillage l’odeur anisée des promesses de l’été qui vient. A son retour, elle a l’odeur des châtaignes rôties et des feuilles mortes. Oui, c’est ça, cette heure est une odeur, celle de ma vie qui passe. Elle rallonge l’hébétude des nuits d’hiver et l’aveuglement solaire des jeunes après-midi de printemps. Et pourtant, la longueur comptable du jour ne change pas. C’est l’ordonnancement du temps qui bouge, qui vient pousser encore ce que la Nature fait très bien toute seule: allonger la lumière. Nous agrandir les pupilles pour s’emplir de cette lumière, pour ne pas se détruire quand elle se sera épuisée de nous lécher. Pour qu’on garde quelques feuilles sur le dos pour quand il fera froid. Pour qu’on se rappelle qu’il y a toujours un lendemain. Pour que l’on se souvienne qu’il faudra vivre encore pour apaiser nos corps douloureux aux dardements du soleil. Qu’ils reviendront, le goût du sel sur nos peaux et le vent doux dans nos cheveux. Comme reviendront la morsure du feu et l’humidité glacée qui monte des soirs de novembre.
Besito