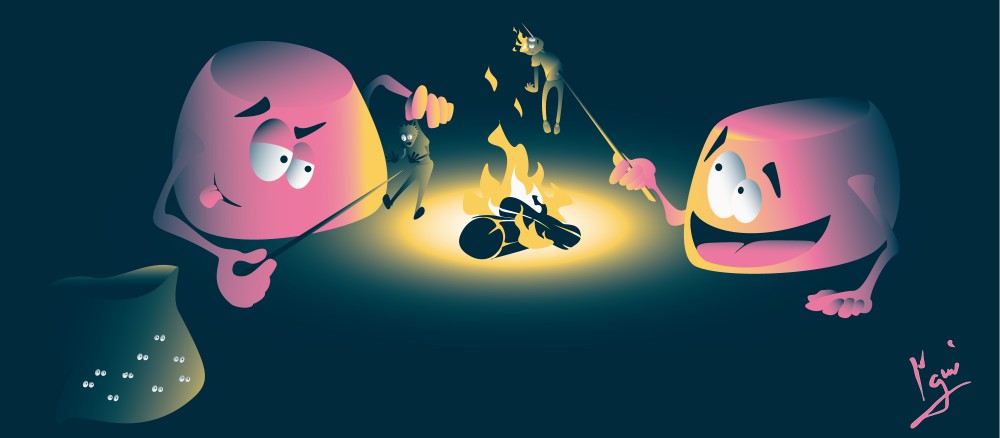De Mimi
L’autre matin, comme tous les matins, je n’étais pas bien réveillée. Alors, comme toujours, je buvais beaucoup de café, noir, sans sucre, réchauffé de la veille au micro-onde. Le chat piaulait pour avoir à manger, ou sortir sur le toit, ou les deux. Et je fumais. Et je regardais par la fenêtre de ma cuisine. Cette fenêtre donne sur une grande cour. Ou a l’air de donner sur une grande cour, parce que de la table de ma cuisine, je ne vois pas en bas. Mais je vois un bon coin de ciel, d’autres fenêtres, une terrasse loin en face, avec des canisses et du linge pendu. Bref, ce que plus ou moins tout le monde voit, à Marseille par la fenêtre de sa cuisine.
Ce matin-là, mon regard flottait au dehors quand il fut happé par quelque chose qui n’était pas au-delà de l’encadrement de la fenêtre mais à l’intérieur. Chez moi. Dans ma cuisine. Sur ma planche à découper. Dans un de mes bols à Welsh. Dans un pot en plastique. Dans de la terre trop sèche. Un plant de basilic. Je savais qu’il était là. Guillaume l’avait acheté la veille pour faire un pesto, opération finalement avortée au profit de je ne sais plus quoi exactement, peut-être bien une tarte aux légumes. Je savais qu’il y était mais je ne l’avais pas vu. Pas regardé. Pas compris. Et là, ce matin-là, il m’est apparu. Et mon esprit a tenté, embrumé encore, d’intégrer ce pot de basilic. Alors le flash : ce pied de basilic était une bête que l’on mène à l’abattoir. De même nature que ces veaux, vaches, cochons, canards, poulets, poissons de batterie, courgettes, pommes-de-terre, escargots, carottes et toute la sarabande. De ceux dont l’existence ne se justifie que par leur future dévoration, mastication, digestion, cuisine. A des années-lumière des animaux et des plantes de compagnie. Ceux et celles que l’on choie, que l’on peigne, dont on dégage soigneusement les oreilles, que l’on arrose, nourrit, à qui l’on parle doucement dans le noir, dont on espère la croissance tranquille mais sûre, dont on s’inquiète pendant les vacances, de qui on confie la garde à des personnes de confiance. Dont on chérit la vie. Alors que d’autres, infortunés, marchent en file indienne vers leur sacrifice, que l’on donnera même en pâture, pâtée aux beaux élus de nos vies domestiques, ils vivent. De toute évidence, le basilic ira rejoindre la cohorte de ces nés pour mourir, ratatouille sans issue.
Voilà ce que je griffonnais, esquisse, sur le cahier qui est toujours posé sur la table de ma cuisine: basilic=animal de batterie ≠ plante de compagnie.
Au grand étonnement de Guillaume à son réveil, après mon départ. Mais ça l’a fait rire apparemment.